Menu
Lire la Bible - Revue N°94 - Septembre 2025
Pour une véritable intelligence des Écritures
Lire la Bible au pied de la lettre, l’ouvrir au hasard en quête de réponse, choisir tel chemin pour l’approcher... Des pratiques qui touchent à la vie spirituelle, et que la tradition ignatienne éclaire.Dans un monde saturé de contenus où la parole peine parfois à se faire entendre, accéder à la Bible ne va pas de soi. Certains se demandent si on peut la lire en l’ouvrant au hasard, y chercher une réponse immédiate à une question précise, ou la comprendre sans initiation aucune... Ces questions, apparemment naïves, touchent en réalité à des enjeux majeurs de la vie spirituelle et de la mission de l’Église : la formation biblique de tous les baptisés, le travail d’interprétation des Écritures, le discernement dans la prière. C’est la grande richesse de la tradition ignatienne que de nous apprendre à lire, non pas d’abord pour « savoir », mais pour aimer et suivre Jésus Christ.
L’Écriture Sainte n’est pas un texte tombé du ciel. Elle porte l’histoire du salut en Jésus Christ par la médiation de voix humaines dans des cultures, des contextes et des genres littéraires différents. Fruit du concile Vatican II, la constitution Dei Verbum (DV ; lire aussi notre article p. 16, ndlr) affirme que « les réalités divinement révélées, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y ont été consignées sous l’inspiration de l’Esprit Saint » (DV n° 11), mais sans confondre inspiration et dictée littérale : « Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels Il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, Lui-même agissant en eux et par eux, ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement » (DV n° 11). Lire la Bible au pied de la lettre, sans médiation ni compréhension historique, c’est donc trahir sa nature de Parole incarnée. L’Église catholique condamne fermement le fondamentalisme biblique qui nie la nécessité d’un réel travail d’interprétation des Écritures. La Commission biblique pontificale affirme que cette lecture « est dangereuse, car elle est attirante pour les personnes qui cherchent des réponses bibliques à leurs problèmes de vie. Elle peut les duper en leur offrant des interprétations pieuses mais illusoires, au lieu de leur dire que la Bible ne contient pas nécessairement une réponse immédiate à chacun de ces problèmes¹ ». Elle emprisonne la foi dans un carcan. À l’inverse, la tradition ignatienne s’inscrit dans une écoute intelligente et priante de l’Écriture. Ignace n’était pas exégète, mais il comprenait la profondeur existentielle de la Parole. Son expérience de conversion passe par une lecture méditée, intérieurement goûtée, où le texte devient lieu de rencontre. Lire la Bible, c’est se laisser rejoindre par Jésus Christ.
Un signe, un souffle
Faut-il pour autant condamner l’ouverture « au hasard » de la Bible, pratique courante dans certains milieux pastoraux ? Pas nécessairement. Le cœur cherche parfois un signe, un souffle. Mais sans discernement, ce geste peut vite basculer dans la superstition ou la projection affective. Ouvrir la Bible comme on recherche un oracle ou une prédiction, attendre une réponse immédiate sans prendre en compte le contexte ni interroger ses propres désirs, c’est risquer de tomber dans l’illusion.Le passage de la pendaison de Judas en est un bel exemple (Mt 27,3-10). Imaginons que je cherche une solution à un problème complexe, que je décide de m’en remettre à ce que trouverai en ouvrant la Bible au hasard et que je tombe sur ce passage où Judas, pris de remords après sa trahison, se suicide. Qu’est-ce qu’un tel passage marqué par le désespoir pourrait alors signifier pour moi ? Dieu ne parle pas par des slogans, mais par des appels qui sont à interpréter dans la durée.
Sur ce point, la sagesse de la pédagogie ignatienne est précieuse. Loin de rejeter l’inattendu, elle invite à l’éprouver. La Parole lue ou entendue est confrontée aux mouvements intérieurs de consolation et de désolation. Le texte biblique devient alors un lieu d’appel, à condition que je discerne intérieurement ce qui me touche, me dérange, me convertit. Mon cœur devient le terrain d’une révélation non pas magique, mais spirituellement active. C’est un apprentissage long, mais infiniment riche pour la vie spirituelle.
L’un des défis majeurs de l’Église catholique aujourd’hui est d’encourager un maximum de baptisés à un accès libre et éclairé de la Bible. La réforme du concile Vatican II a permis une plus grande familiarité avec l’Écriture, en encourageant à la lecture intelligente et catéchétique des textes et en multipliant la lecture des passages bibliques dans le cadre liturgique. Mais beaucoup reste encore à faire.
Nombre de fidèles, désireux de nourrir leur foi, se retrouvent seuls face à des textes complexes, voire choquants ou peu audibles dans le contexte moderne. Cette solitude ouvre parfois la voie à des lectures erronées, sélectives ou idéologiques. D’un autre côté, certains groupes se replient sur une lecture facile, univoque, coupée de la Tradition et d’un travail d’interprétation et de discernement. L’Église catholique a donc mission de former un maximum de ses membres à la lecture et à l’interprétation des Écritures, non pour imposer une seule lecture, mais pour initier à un art d’interpréter le texte à la lumière de l’Esprit. Les outils ne manquent pas, les services diocésains de formation et les universités catholiques redoublent de propositions. Mais l’appétit n’est pas souvent au rendez-vous !
La lecture ignatienne, avec sa structure souple et rigoureuse, offre une voie possible. Elle conduit progressivement à apprendre à s’immerger dans les scènes bibliques (méditation, contemplation), à laisser résonner la Parole dans la vie concrète (application des sens), à relire ce qui a été vécu intérieurement (examen spirituel), et à distinguer ce qui conduit à la vie de ce qui enferme (discernement des esprits).
Ce type de lecture ecclésiale, à la fois personnelle et communautaire, rejoint l’espérance d’une Église synodale : marcher ensemble dans l’interprétation de l’Écriture, avec le Christ au centre, Parole vivante. Le partage biblique et le dialogue contemplatif, régulièrement pratiqués dans nos équipes CVX, sont de belles occasions de croissance spirituelle personnelle et communautaire. Ce sont des trésors qu’il est possible de partager autour de nous pour que d’autres frères et sœurs en profitent à leur tour.
Que la Parole devienne chair
Cependant, lire la Bible ne suffit pas. Il faut que la Parole devienne chair en nous, qu’elle change nos choix, nos relations, notre espérance. L’Évangile de Luc, dans l’épisode des pèlerins d’Emmaüs, en donne un exemple : les disciples ne comprennent pas, écoutent le commentaire de l’Écriture, puis reconnaissent le Christ à la fraction du pain. Ce n’est qu’alors qu’ils prennent conscience de leur cœur tout brûlant (Lc 24,32). La lecture biblique porte en elle une force de conversion qui appelle une responsabilité collective. Elle interroge les structures de péché, ouvre des chemins de justice, suscite des appels à la mission. La Parole ne revient pas sans effet (Is 55,10-11), à condition qu’elle soit accueillie avec foi, liberté et intelligence.Ainsi, il est bien de la responsabilité de l’Église, donc aussi de celle de chacun d’entre nous, de promouvoir les formations bibliques, de favoriser des lieux de lectures priantes de l’Évangile dans les communautés, de former des accompagnateurs spirituels et des exégètes compétents en ce domaine.
Dans la tradition ignatienne, lire la Bible, ce n’est pas consommer une vérité, mais marcher avec le Christ. C’est accepter de se laisser rejoindre là où l’on est, parfois dans le désordre de nos vies, mais avec le désir d’y voir clair. Ce n’est pas la méthode qui sauve, c’est l’attitude intérieure, la disponibilité au souffle de l’Esprit, l’écoute communautaire. Contre la tentation de la lecture magique, narcissique ou fondamentaliste, nous pouvons en Église proposer une autre voie : celle d’une lecture lente, priante, éclairée, qui conduit à la conversion ; une lecture où la Bible ne dit pas seulement ce que je veux entendre, mais ce que je suis appelé à devenir en Jésus Christ.
Isabelle Morel
¹L’interprétation de la Bible dans l’Église, § 1F, 1993.
Docteur en théologie catéchétique, Isabelle Morel dirige l’Institut supérieur de pastorale catéchétique à l’Institut catholique de Paris. Elle est membre du Conseil international de catéchèse à Rome.

L’ouverture « au hasard » de la Bible, courante dans certains milieux pastoraux, nécessite
un certain discernement.
© Alain Pinoges /CIRIC
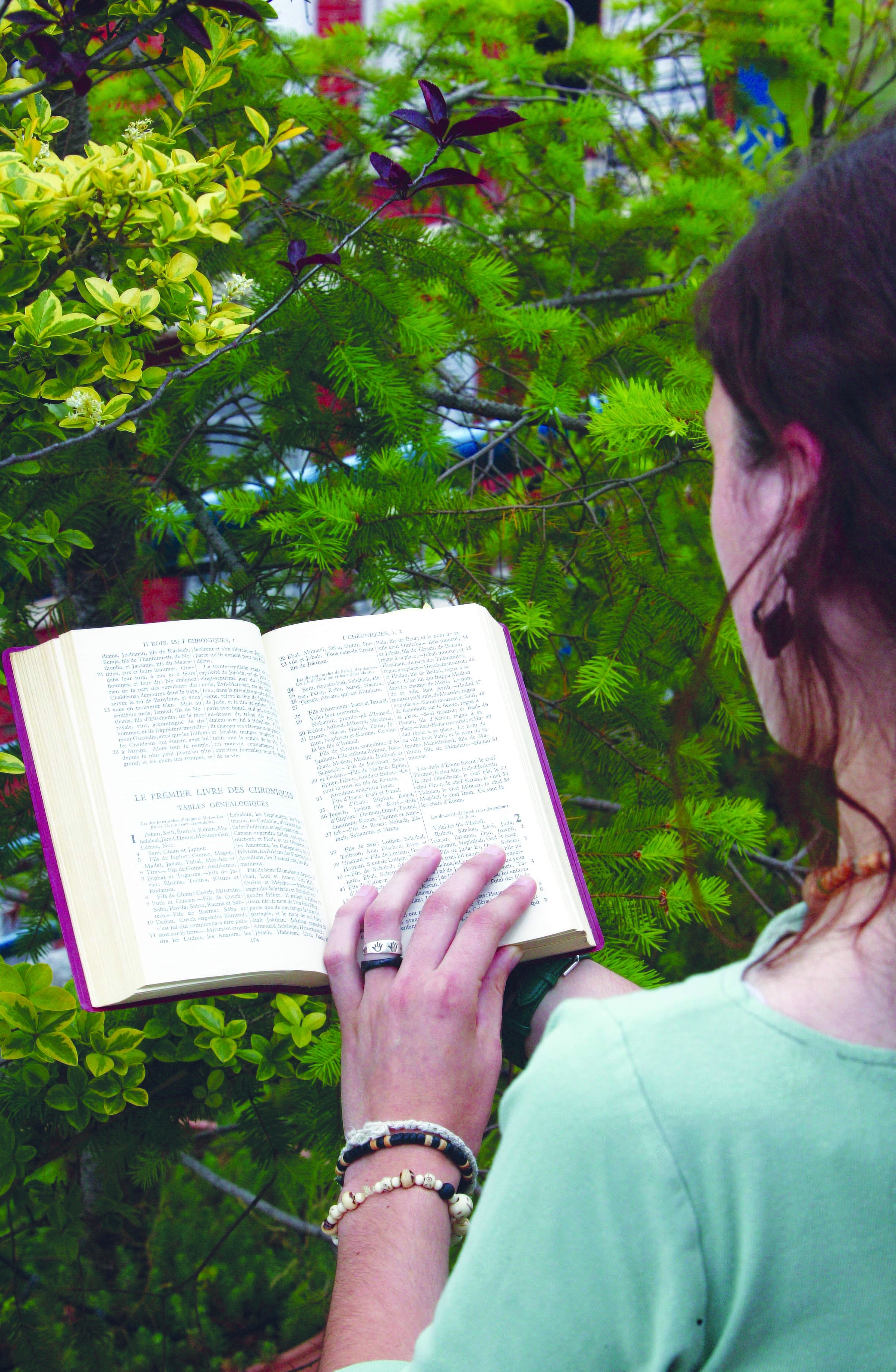
Lectures « magique », narcissique ou fondamentaliste : des écueils qu’une saine formation biblique permet d’éviter.
© Pascal Deloche / Godong
Télécharger la revue n° 93 gratuitement
La revue n° 93 sera disponible dans votre dossier Téléchargements
Pour télécharger une autre revue, cliquez sur l'image de la revue souhaitée ci-dessous.
La revue n° 93 sera disponible dans votre dossier Téléchargements
Pour télécharger une autre revue, cliquez sur l'image de la revue souhaitée ci-dessous.





 Impression
Impression  Envoyer à un ami
Envoyer à un ami